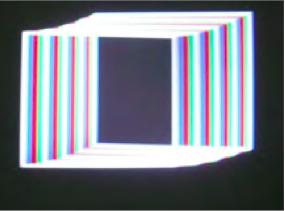Propos recueillis par Sophie Rusniok et Julie Jourdan dans le cadre de la 65e édition de Jeune Création, automne 2014.
Tangible, 2013. Tige de verre, feuille d’aluminium peinte en blanc pliée, projecteur découpe 75,5 x 48 x 26 cm. © Hugard & Vanoverschelde.
Julie Jourdan : Tu as une formation de sculpteur mais ton sujet premier (la lumière) est immatériel. C’est assez étonnant, comment en es-tu arrivé là ?
Pierre-Pol Lecouturier : Il n’y avait rien de prémédité à l’origine. J’ai fait une formation classique de préparation aux Beaux-Arts, où j’ai été sensibilisé assez jeune à la pratique du dessin, aux contrastes lumineux, aux volumes. Sans vraiment m’en rendre compte, j’ai commencé à comprendre que la lumière nous permettait de voir, de créer des volumes. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé au cinéma, lorsque j’étais à Paris 8. Puis, j’ai suivi les ateliers de Sèvres où, de fil en aiguille, j’ai pu explorer un peu de tout. J’ai alors intégré La Cambre en gravure et jusqu’à ce moment–là, en 2003, je n’étais pas encore très orienté dans ma pratique artistique. Arrivé en gravure, j’ai commencé à m’ennuyer. Il faut être patient pour graver, c’est une discipline d’ascète. J’étais un peu trop impatient alors je me suis dirigé vers la sculpture. C’est à partir de là que j’ai développé ces recherches sur la lumière, progressivement.
Sophie Rusniok : C’est-à-dire ? Fais-tu remonter cet intérêt à un moment, un souvenir en particulier ?
PPL : J’ai été frappé par l’impact et l’efficacité de la lumière au niveau de la perception. J’ai un souvenir assez net d’une visite d’exposition à Pompidou sur des artistes californiens. J’ai en effet été subjugué par le phénomène de nuisance visuelle lors d’une projection, plus connue aujourd’hui, lorsqu’apparaissent le rouge, le vert et le bleu du vidéo-projecteur. Je me demandais si c’était un problème dû à l’appareil ou si c’était moi qui était fatigué. Il s’en est suivie une légère angoisse. A partir de là, je me suis renseigné auprès des constructeurs sur la technologie employée. J’ai mis ça de côté, ne sachant pas trop quoi en faire ; je n’avais pas encore de discipline de plasticien à ce moment-là. Je sortais du dessin, de l’illustration et j’étais un peu mal à l’aise avec les installations d’art contemporain. Puis j’ai rencontré Ann Veronica Janssens, intervenante à La Cambre, qui m’a aidé à développer ce travail et je n’ai pas arrêté depuis. Ça a créé un espace de liberté où je pouvais m’aventurer dans de nombreux médiums. N’avoir aucune restriction était assez agréable, je pouvais capter des choses à l’extérieur, notamment avec des caméras. J’ai commencé à beaucoup m’amuser avec cela, les flares, les contrastes, les contre-jours… Tout ce qui rendait l’image un peu surréelle et magique.
SR : Donc par l’expérimentation ?
PPL : Oui, de fil en aiguille, avec la caméra, l’optique de la caméra, que j’ai tronquée et/ou modulée en ajoutant d’autres lentilles afin de noter les déformations que cela pouvait créer. En parallèle, je faisais des expérimentations avec des vidéos projecteurs.
JJ : Ton intérêt pour ces questions trouve donc aussi son origine dans tes études de cinéma ?
PPL : Oui, le cinéma allait également dans ce sens même si ce n’était pas vraiment conscient à cette époque. J’ai toujours été sensible à l’image, à la caméra, la projection de l’image. Je pense qu’elle a quelque chose de magique, lorsqu’elle apparaît sur l’écran blanc et que la poussière se prend dans le faisceau et se matérialise. On a tous été un peu séduits par ça. En parallèle, mon frère était aussi à Bruxelles. Il avait fait ses études de cinéma à Paris 8 également et poursuivait sa formation à l’INSAS, l’équivalent de la FEMIS. Je l’ai suivi dans des projets de film, j’ai conçu des storyboard etc. Je suivais un peu son cursus par procuration.
 Mirror, 2013. Lentille de Fresnel peinte en noir. © Hugard & Vanoverschelde.
Mirror, 2013. Lentille de Fresnel peinte en noir. © Hugard & Vanoverschelde.
SR : Ton travail nécessite souvent un déplacement du spectateur pour que l’œuvre se révèle, il faut se déplacer, tourner autour, ce qui implique une certaine temporalité. On n’a pas accès à l’œuvre immédiatement. Le temps, la temporalité ont-ils une place particulière dans ton travail ? Tu parlais également d’impatience tout à l’heure…
PPL : L’impatience dont je parlais, c’était cette ébullition, cette effervescence lorsque l’on a vingt-trois, vingt-quatre ans et que l’on a envie de toucher à tout. Elle était aussi un besoin de créer de nouvelles formes, de trouver un espace de liberté qui va avec son tempérament. Ensuite, une fois que la pièce se dessine, je prends beaucoup plus de temps à l’observation. Finalement, autant j’ai pu être impatient, autant je suis aussi très contemplatif. Je peux passer un long moment à regarder. Cela me vient peut-être de la pratique du dessin et du modèle vivant où on a le temps de rentrer dans une autre dimension où le corps est désincarné ; on ne voit que des photons, des volumes.
SR : Tu veux dire par là que quelque chose d’autre émerge après un certain temps d’observation, un état d’esprit ? Que l’on peut dériver vers une forme d’hypnose ?
PPL : Oui je pense, la contemplation est de l’ordre de l’auto-hypnose. La chose ne se révèle pas autrement, elle ne devient pas autre chose, évidemment – il faudrait prendre des produits chimiques pour cela – mais elle prend un volume différent. De ce point de vue, il est vrai que je demande un peu de temps aux personnes qui ont envie d’observer mon travail.
Il y a des objets que j’ai pu concevoir comme des accidents de parcours. C’est le cas pour Abstraction (2012) qui était initialement un petit test. Le carton recouvert de feuilles d’or s’est pliée en deux par erreur et je l’avais laissé de côté pendant un an. Il est devenu intéressant lorsque j’ai voulu le reproduire en grand format et l’offrir à l’observation, avec ce pli qui vient former une ombre créant un horizon. J’aimais bien cette ouverture grâce au format. Il y a aussi ce désir de poésie dans les objets que j’essaie de mettre en place. Quand d’un objet émane de la poésie, ça m’intéresse.
 Abstraction, 2012. Carton plié, feuille d’or, 80 x 80 cm. © Hervé Abbadie.
Abstraction, 2012. Carton plié, feuille d’or, 80 x 80 cm. © Hervé Abbadie.
Du temps d’observation oui… Parfois, ce qui est à voir n’est pas ce qui se donne au premier abord, comme dans Map (2012) un tube enroulé avec un fond gris à l’intérieur. Beaucoup de personnes qui l’ont vu sont passés à côté, ce sont dit « tiens, un tube en métal ». En fait, les superpositions de feuilles de Rodhoïd créent des interférences de lumière. C’est le même principe physique de la lumière qui se prend dans une tache d’essence sur une flaque d’eau. Cette épaisseur entre les films plastiques transparents, nettoyés à l’alcool qui plus est, provoque ce genre de phénomène. Cela apparaît avec le plastique mais également avec le verre. J’amène les spectateurs à regarder dans le détail de l’objet. C’est un parti pris de ne pas offrir absolument tout, de ne pas rendre tout visible. Il y a déjà beaucoup de choses qui se donnent d’elles-mêmes à voir, et plus c’est gros mieux c’est. On reconstitue des univers où l’on englobe le spectateur. C’est de plus en plus à la mode. A rebours de tout ça, dans une tradition minimale, j’ai le désir que le spectateur s’attarde un peu plus, et pas seulement sur des formes géométriques, ce qui serait plutôt le travail des minimalistes dans les années 60 où la forme industrialisée était donnée d’emblée, telle quelle.
 Map, 2012. Plastique, papier, clous, 100 x 5,5 cm.
Map, 2012. Plastique, papier, clous, 100 x 5,5 cm.
Map, 2012 (détail).
JJ : Est-ce pour cette raison que tu parles d’ « interaction cognitive entre objet et spectateur » ? Finalement, l’objet ne se donne que si le regardeur prend la peine de s’y attarder.
Le regardeur prend la peine – ou pas – de voir. Une autre pièce, Reflect (2012), en est peut-être un exemple plus frappant. C’est une feuille de verre anti-reflet au format A4, posée à l’angle d’un mur, tenue par quatre petites têtes d’épingle. De loin, on ne voit que les tranches verticales. Elles peuvent faire penser à des traits au crayon carbone sur le mur ou à deux fils tendus entre deux clous. On peut même ne rien voir. Ce qui m’intéresse dans cette discrétion, cette quasi-invisibilité, c’est aussi le fait que les spectateurs puissent en parler entre eux, qu’ils puissent échanger en se disant : « As-tu remarqué cette pièce ? ». J’aime ainsi créer cette impression de frustration alors que le spectateur est dans l’espace, qu’il est sur le lieu même mais qu’il n’a pas vu toutes les œuvres. Il arrive à chacun de passer dans une exposition et de manquer une pièce dont tout le monde parle. C’est un parti pris dans mon travail de jouer sur ce presque visible, ou de voir l’objet mais de ne pas voir où se situe l’intervention. Mais ce n’est pas si important : une pièce peut s’aborder – et c’est mieux – en plusieurs temps. On ne la consomme pas comme ça, immédiatement. Ça rejoint ce que vous disiez par rapport au principe de contemplation. L’œuvre se révèle différemment avec le temps passé à la regarder.
 Reflect, 2012. Verre anti-reflet, clous, 19,2 x 28,6 cm. © Hugard & Vanoverschelde
Reflect, 2012. Verre anti-reflet, clous, 19,2 x 28,6 cm. © Hugard & Vanoverschelde
SR : Tu ne cherches donc pas une efficacité immédiate. Est-ce toujours le cas ?
PPL : Ça dépend. Par exemple, la pièce que j’ai présentée pour Jeune Création, Particules (2011-2014), un spot qui éclaire le sol où sont disposées des microbilles de verre, se fait très discrète. Le spectateur ne sait pas trop ce qu’il y a avoir et lorsqu’il s’approche, un arc-en-ciel apparaît et vient happer le regard, cette fois-ci, de manière assez visible.
Particules, 2011-2014. Microbilles, spot 300W, dimensions variables. © Caroline Marlier
SR : Comment parviens-tu à prendre en compte la diversité des points de vue des spectateurs, tant en terme de vécu que de position dans l’espace d’exposition ?
PPL : L’expérience se situe dans le regard de chacun. Chaque spectateur voit son propre arc-en-ciel, son prisme. Il n’y a pas de lieu unique et figé à partir duquel observer mes pièces. Cela se joue dans une relation intime à l’œuvre.
JJ : Lorsque tu dis que chacun voit son propre arc-en-ciel, tu sembles rejoindre des problématiques qui sont celles de la phénoménologie, qui considère également l’apparition des phénomènes à partir de l’expérience vécue. Tu as déjà employé toi-même cette terminologie, comment t’appropries-tu cette pensée ?
PPL : Disons que je me retrouve dans certains écrits de Merleau-Ponty et de Bachelard. J’ai une légère formation en philosophie mais je ne revendique aucun bagage. Je prends cela avec des pincettes. Je pense que des spécialistes parleront mieux que moi-même de cet aspect de mon travail. J’ai cependant été marqué par le dernier écrit de Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, un des plus accessibles. J’aimais beaucoup cette manière de considérer le regard et la perception comme ayant lieu dans ce double mouvement de vision du regardeur à la fois voyant et vu. Selon moi, ce n’est d’ailleurs pas qu’un écrit philosophique mais aussi poétique. C’est comme lorsque Merleau-Ponty parle de la piscine qui se révèle à travers son élément, l’eau. Il y a une sorte de renversement de la perception, de déviation de sens où les choses se donnent à voir plutôt qu’elles sont vues par un regardeur.
JJ : En fait, chacun fait la moitié du chemin. L’objet appelle autant le regard qu’il est vu par un regardeur.
PPL : Oui. Il y a une triangulation entre la pièce, le regardeur et la rencontre des deux. Dans la phénoménologie, j’apprécie l’interprétation personnelle que l’on peut dégager. Je n’aime pas imposer ce que la personne doit regarder ou pas. Je ne surcharge pas mon travail de concepts lourds qui viendraient l’obturer ou devenant comme une seconde chose menant sa vie propre.
SR & JJ : Au sujet de l’idée d’interaction dans ton travail, qui n’est en effet pas évidente au premier abord. Comment considérer cette ambivalence, cette interdépendance et cette distance à la fois ?
PPL : C’est vrai qu’il pourrait y avoir une certaine réserve dans mon travail. Je pense que, comme je n’ai pas la volonté de produire un spectacle, placer le spectateur en position de simple spectateur ne m’intéresse pas. Je demande au public un petit effort pour accéder à ce que je désire montrer. Ne pas tout donner créer aussi du désir de voir.
SR : Une forme d’érotisme peut-être…
PPL : Peut-être. Cela crée une intimité en tout cas. J’essaie de prendre en compte notre échelle, que l’on soit sollicité par notre corps pour se déplacer autour de l’œuvre, et prendre également en considération l’espace dans lequel l’œuvre a été installée.
JJ : Il est vrai que tu sembles jouer avec l’espace qui t’est offert. Certaines de tes pièces sont accrochées au mur, d’autres sont simplement posées sur le sol. Quel rôle occupe l’espace dans ton travail ?
PPL : S’ il y a le travail en lui-même, il y a aussi celui de présentation. Certaines pièces fonctionnent sur tel mur mais pas sur tel autre car un certain reflet ne doit pas nuire à leur appréhension. D’autres demandent au contraire la lumière directe. Il y a déjà un important travail de scénographie. Je suis sensible au fait que les spectateurs puissent voir les œuvres, considérer les phénomènes – si il y en a – mais voient aussi l’emplacement et l’architecture qui les reçoit.
SR : Là aussi c’est phénoménologique dans un sens. Au contact de tes pièces, la perception de l’espace change. Si tes pièces ne peuvent pas être placées n’importe où dans l’espace d’exposition, suivant sa configuration et son architecture, c’est que l’espace influence tes œuvres. Le parcours du spectateur aussi ?
PPL : Oui, il y a un travail sur le temps de la déambulation. Par exemple, je suis attentif à la première et à la dernière pièce que le spectateur est en mesure de voir dans l’espace d’exposition. Si je dois supposer un parcours prédéfini, je l’imagine exactement comme on construirait un film où chaque étape impose son timing. Le parcours peut être classique, commencer par une introduction pour nous conduire au cœur du travail ou inversement, commencer par la fin, comme dans Pulp fiction, où le film débute par le dénouement pour reconstruire peu à peu la trame narrative. Les pièces fonctionnent entre elles, il y a des leitmotiv qui reviennent. Il y a un temps imparti pour le déplacement,. Des choses sont à voir frontalement, d’autres de biais, d’autres encore autour desquelles il faut circuler, où il faut aller de gauche à droite, d’autres où il faut seulement bouger les yeux pour discerner un phénomène de scintillement par exemple.
SR. : Et concernant les matériaux utilisés : ils se présentent comme des matières premières mais tu utilises aussi des matières comme l’acier brossé ou aluminium anodisé, qui sont malgré tout issues d’un processus industriel. Comment procèdes-tu à ces choix ?
PPL: J’ai toujours l’envie d’utiliser des matériaux simples, voire désuets, de la matière première. Je cherche à magnifier ces matériaux, les donner à voir autrement, dans un contexte d’exposition, dans une galerie. L’acier brossé par exemple donne des effets de lumière intéressants. La lumière se condense dans le brossage du matériau et se révèle en ligne droite. Je travaille sur la lumière mais également sur les comportements lumineux. Ils se révèlent en fonction de la matière. Mais je ne veux pas basculer dans les effets spéciaux. Dès qu’il y a une machinerie un peu importante à mettre en place, ne serait-ce que de l’informatique, des capteurs, cela devient trop compliqué. Il est important, pour tenter de comprendre ce que l’on a sous les yeux, d’avoir, autant que faire se peut, toutes les cartes en main pour être en mesure de reconnaître la nature les matériaux utilisés. Dans la mesure du possible bien sûr, car tout le monde ne connait pas les lentilles Fresnel ou les outils d’optique que j’ai pu utiliser. Les microbilles sont des éléments servant pour le marquage au sol. J’apprécie le fait qu’elles soient issues d’une utilisation brute et de pouvoir en faire une présentation plus raffinée. Il y a des artistes que j’aime beaucoup, qui n’utilisent presque rien, je trouve cela magnifique, comme Clément Rodzielski qui a présenté récemment son travail chez Chantal Crousel. En terme de travail, il n’a rien à voir avec le mien mais c’est comment faire quelque chose avec quatre bouts de ficelle, trois coups de pinceau. Je trouve cette simplicité magique. Cela nous prémunit peut-être de toute cette technologie environnante, de notre société hypercomplexe – sans proclamer un point de vue sur la société, je n’ai pas cette prétention. Mais nous sommes entourés de technologies très élaborées qui nous dépassent, que nous ne mettrions pas une vie entière à comprendre.
SR : Comment interviens-tu sur tes matériaux ? Considères-tu tes œuvres comme des « ready-made » ?
PPL : Mes pièces sont des « ready-made » modifiés, recadrés. Par exemple, pour #1 (2007), le projecteur est placé sur un socle. Il n’y a que l’image d’un cadre blanc sur un fond noir qui lui a été ajoutée. Je n’ai pas touché à la technologie du projecteur. Tout le monde peut, chez soi, réaliser ce dispositif. Dans Corner (2010), la tôle d’Inox courbée entre deux murs est purement industrielle. Finalement, je ne conçois sur cette pièce que le système d’accrochage mais je ne laisse aucune trace de la main.

#1, 2007. Projecteur video DLP, DVD.
#1, 2007. Détail.
SR : C’est en ce sens encore que se joue un dialogue performatif entre tes pièces et l’espace d’exposition, la sculpture l’interpellant et le mettant en évidence. On a ici un effet de miroir, de réflexion. Finalement, l’espace et le temps de ta pratique ne se limitent pas à la réalisation de la pièce comme objet fini.
PPL : Elle questionne aussi l’architecture. Pour l’instant, je ne sais pas si elle est architecturale mais c’est une voie dans mon travail qu’elle devienne une démarche sur un bâtiment. Dans ce cas, je questionnerai le projet différemment. Aujourd’hui, j’en suis encore à des formats relativement petits.
Il y a des ready-made, comme cette boîte de cure-dents disposés dans une barque ronde, où le simple fait de les rassembler et de les poser dans ce récipient en bois dans l’espace d’exposition fait œuvre. Récemment, j’ai commandé six mètres de feuille de plomb, que l’on utilise pour le revêtement pour les toits, brute, grise. Je l’ai coupé en deux et mis au sol pour en faire un tapis de 2 x 3 m que j’ai ensuite polis sur toute la surface pour la rendre miroitante. J’ai réalisé moi-même le travail de polissage. J’interviens de manière ponctuelle ou du moins, pour une chose bien déterminée comme polir une surface, ce qui peut prendre énormément de temps. Ce n’est pas nécessairement un gain de temps d’intervenir sur l’épaisseur du matériau par exemple.
Picks, 2010. Bois, 8,5 x 56,5 cm de diamètre. © Florian Kleinefenn.
SR : En définitive, quand tu interviens sur la matière, tu le fais efficacement, mécaniquement, comme tu préparerais une surface comme support.
PPL : Disons que je n’évite pas totalement la trace de la main mais je ne la mets pas en valeur parce que c’est déjà un geste qui en soi, induit un possible égarement du spectateur vis-à-vis de ce que je désire montrer. La trace de la main peut supposer une forme de « romantisme », de l’ordre de la peinture, du peintre. Je ne suis pas désintéressé mais j’essaie au maximum de ne pas perturber le regard. Je revendique un peu cette posture, de ne pas montrer de talent dans l’ouvrage, dans le savoir-faire. Comme ces verres que j’ai repeints en noir à l’aérosol qui laisse transparaître la poussière de peinture. Mon souci pour ce travail-là avait été d’obturer le verre et de ne pas prêter attention au passage de la main. Je me suis chargé de faire le noir total sans me soucier de la manière de faire, mécaniquement. Suite à ce mouvement mécanique apparaît cette surface noire obturée. Ce qui m’amuse, c’est qu’elle induise des nuages dans un ciel nocturne alors que l’initiative n’allait pas dans ce sens-là puisqu’elle était aléatoire.
Back of mirror, 2012. Peinture noire sur verre encadré, 80 x 80 cm. © Hugard & Vanoverschelde.
JJ : C’est là où le spectateur a un rôle.
PPL : Oui, c’est l’imaginaire du spectateur qui est convoqué, c’est le test de Rorschach où chacun voit les formes qu’il veut.
SR & JJ : Tes sculptures sont issues de phénomènes que tu dégages des propriétés physiques des matières et surfaces que tu utilises. Comment travailles-tu pour découvrir ces phénomènes, ce que tu appelles les « comportements lumineux » ?
PPL : J’aime bien que mon travail soit alimenté par des rencontres faites dans le quotidien, comme une bulle de savon et les irisations de lumière qu’elle produit, même si dans ce cas, on rentre dans une séduction que je ne recherche pas. Toutefois, il se trouve que le phénomène en soi est intéressant. Je m’intéresse aussi aux effets de volumes, de 3D, que produisent les rayons concentriques de ce disque de métal brossé sous nos yeux. J’apprécie le fait de dégager des phénomènes du quotidien. Aussi, quand le quotidien manque à me donner des directions, je vais les chercher sur internet, je regarde des matériaux, les sites où des gens font des expériences. Je trouve qu’on peut trouver plein de choses incroyables. Ou alors, je me déplace dans les usines, je vais voir les matières, les qualités. Je cherche des matériaux, optiques par exemple, sans avoir d’idée prédéfinie sur leur nature. Il faut qu’ils interagissent un tant soit peu avec la lumière. Je regarde et je me laisse toute liberté de procéder, il n’y a pas une manière unique de faire. Après un moment d’errance, une idée émerge. J’essaie alors de la mettre en place pour en faire sortir quelque chose. On retrouve cette notion de temps dont tu parlais. Paradoxalement, autant je suis impatient – je l’étais en tout cas – autant j’aime bien prendre du temps pour trouver des choses et leur laisser le temps de se révéler.
SR : Et la place de l’atelier dans tout ça ?
PPL : Justement, ça a longtemps été une question. Aux Beaux-Arts de La Cambre, j’étais mal à l’aise avec l’atelier. J’avais l’impression de jouer à l’artiste mettant ses œuvres au mur mais où cela n’est en fait pas autre chose que de la décoration. Je ne parvenais pas à faire en sorte que l’atelier devienne un vrai outil d’investigation. Déjà parce qu’à La Cambre, personne n’a d’atelier pour soi donc on est toujours contrarié par les allées et venues. L’atelier est aussi un moment d’intimité où tu es seul. Je n’avais pas vraiment cette bulle et elle me faisait un peu peur. Pendant longtemps, j’ai travaillé sur carnet, croquis. Je notais des choses, en me baladant à l’extérieur, au gré des discussions etc., peu importe comment l’idée me venait.
SR : Tu retranscrivais dans l’atelier ce que tu voyais dans ton environnement immédiat finalement.
PPL: C’est ça, dans mon atelier qui était finalement mon appartement. J’aimais bien l’idée de home studio. Je consignais dans un carnet puis, dès qu’une exposition se présentait, je mettais en place le projet.
SR. : Cela signifie que l’atelier comme laboratoire t‘est étranger ?
PPL : C’était le cas lorsque je suis sorti de l’école des Beaux-Arts en 2008 avec l’économie qui était la mienne. Le petit bureau que j’avais où j’ai consigné mes recherches permettait d’avoir des pistes de recherches que je pouvais mettre en place dès que l’occasion se présentait. J’ai parlé d’exposition mais ça vaut aussi lorsque j’ai travaillé avec Erna Hecey, une galerie luxembourgeoise. En effet j’ai bénéficié du grand espace de la galerie où j’ai pu mettre en place des objets de grands formats dans le sous-sol. Je me débrouillais toujours pour avoir un espace d’expérimentation pour aller au-delà, sortir du carnet. J’ai longtemps fonctionné comme cela et depuis moins d’un an, j’ai un atelier où j’ai besoin d’avoir cette bulle que je suis parvenu à apprivoiser. J’ai besoin de poser les choses, le plus loin possible et de les tester. Souvent, je me heurte à des caprices physiques. Les phénomènes n’apparaissent pas comme je le veux comme lorsque j’élabore une pièce dans un lieu d’expérimentation particulier où elle fonctionne et qu’en la déplaçant dans un autre lieu, elle ne fonctionne plus. J’ai de plus en plus besoin de mieux comprendre, mieux cerner les enjeux d’un travail que j’élabore.
SR : L’univers des sciences a tendance à isoler un phénomène pour mieux l’appréhender et à recréer les conditions de son apparition dans un environnement aseptisé, qui se veut le plus « neutre » possible. Que penses-tu de cette démarche ? Tes œuvres ont aussi un aspect un peu clinique, épuré. Peut-on voir dans ton travail une démarche similaire ou s’en rapprochant ?
PPL : Disons que, comme mon travail est censé susciter une expérience, il faut que je mette en place des éléments pour que cette expérience soit possible. Il doit y avoir le moins de parasites possible donc tout cet aspect aseptisé, minimal, va dans ce sens. Il faut que le phénomène soit visible et le soit dans les circonstances les plus favorables. Néanmoins, il y a une limite à ne pas dépasser. L’univers des sciences physiques où les scientifiques mettent en place des protocoles précis… Non, je ne cherche pas à déplacer mon laboratoire dans un espace d’exposition. L’idée est inverse : il y a l’espace d’exposition et la question est : comment, avec lui, mettre en place mon travail. Je ne vais pas contrarier l’espace, construire une boîte noire dans laquelle passer un œil. Je ne cherche pas non plus à contrarier la personne venant voir mon travail pour qu’elle se pose continuellement la question de ce qu’il y à voir et de quel point de vue. D’ailleurs, en réfléchissant à l’évolution de mon travail, je me suis aperçu que j’utilisais de moins en moins de technologies et de sources lumineuses artificielles. Du moins, elles sont assez rudimentaires, comme un spot, mais je n’utilise plus de vidéos ni d’installations avec des vidéos projecteurs etc. Mon travail évolue vers des matériaux simples, quitte à ce qu’il fonctionne avec la lumière naturelle. Je vais vers quelque chose de plus dépouillé… Peut-être quasiment à des surfaces où il n’y a plus grand chose à voir, je ne sais pas…
JJ : Donc quand tu parlais de l’interaction avec le spectateur et avec le lieu, tu ne te contentes alors pas de décontextualiser pour recontextualiser ensuite. Tu remets en cause une mise en contexte qui tient compte du lieu d’exposition.
PPL : Oui il y a un entre deux. Pour l’instant mon travail est très partagé sur ce que nous pouvons y voir et la manière dont il se présentera dans le lieu.
JJ : Il y a en définitive aussi une part de hasard car cela peut marcher différemment selon le lieu. Est-ce que tu laisses une place au hasard ?
SR : Oui, est-ce que tu travailles in situ ?
PPL : Oui, je peux avoir des pièces que je fais sur mesure. Il y a en premier lieu une idée qui peut prendre de multiples formes et s’adapter ensuite à l’espace qui l’accueille.
SR : Ce sont des ready-made in situ en fait (rires).
PPL : Oui des ready-made modifiés in situ (rires). Je ne veux pas que mon travail devienne une série de tours de passe-passe ou de magie. L’idée est de porter une attention sur des surfaces et des objets. Parfois le simple reflet d’une lumière peut m’intéresser. Je travaille généralement en deux temps. Il y a la recherche d’un phénomène mais aussi son incarnation dans l’espace du lieu. Dans un accrochage de plusieurs pièces, je prête une attention particulière à leur « cohabitation » au sein du lieu d’exposition.
SR : D’ailleurs te nourris-tu d’expériences visuelles que tu aurais eues dans la nature ou te concentres-tu seulement sur l’environnement urbain ?
PPL : Non je n’ai pas de restriction mais mon travail est proche de l’urbain car je vis dans une ville, mais si une chose se présente à moi quel-que-soit l’endroit, elle me va..
JJ : Mais tu as l’air d’évacuer l’aspect romantique auquel la nature peut faire écho.
PPL : Oui car je trouverais ça trop anecdotique. Ça résiste moins au temps. Je ne sais pas. J’en suis juste incapable.
SR : Je ne parle pas d’une image de la nature à retransposer en tant que telle mais de l’expérience, de reflets, d’humidité, c’est naturel mais transposable à d’autres matériaux. C’est aussi un contexte et des conditions d’apparition : les changements dans la lumière. La lumière de midi, la lumière du soir…
PPL : C’est vrai que cette une bonne question mais c’est un champ que je n’ai pas encore eu le temps d’explorer. Je m’intéresse souvent aux objets manufacturés et industrialisés, et s’en est resté là pour l’instant. Je pense que le travail pourra prendre une autre impulsion et je le questionnerai, mais ce n’est pas en cinq minutes que je pourrais répondre.
JJ : Tu parles de comportements lumineux parfois sous un aspect assez scientifique mais la lumière est aussi chargée de symboles et il y a tout un imaginaire derrière. Tu parles d’apparition, de magie.
PPL : Oui. Toute la symbolique de la lumière m’intéresse et c’est très large. Je me suis aussi intéressé au langage et à un certain lexique emprunté à la lumière, des mots que l’on utilise quotidiennement. C’est incroyable comme nous y sommes intrinsèquement liés. C’est l’origine de la vie, le fait que nous soyons là. La vue s’est forgée en fonction des comportements lumineux et cela est vraiment intime. Cela n’est pas nécessairement montré dans mon travail actuellement mais je m’intéresse énormément à tout cela, davantage qu’au caractère scientifique. Je n’ai aucun bagage scientifique, je n’en veux pas. J’ai envie de formuler un travail qui est vraiment vivant, donc emprunter des formes géométriques, neutres, mais pour une expérience vivante. J’essaie tant bien que mal de dégager cette poésie. Mes objets sont aseptisés mais je ne veux pas dégager une atmosphère telle. Les objets sont dénués de personnification, d’identité, de trait de caractère dans l’idée d’ouvrir le champ des interprétations possibles.
SR : Comme avec la pièce Reflection et la signification double de son titre.
PPL : Oui, nous avons peu évoqué la question des titres mais j’ai recherché l’ambivalence des termes dans le langage, francophones ou anglo-saxons,. « Reflexion » en effet je trouve cela intéressant lorsque nous disons que nous réfléchissons, et que nous pensons à l’action de la lumière sur une surface. Pour moi le comportement de la lumière est très proche de notre psychisme. On s’approprie très vite la lumière, il y a quelque chose d’immédiat et on en fait quelque chose de personnel. Donc en effet la symbolique m’intéresse et beaucoup d’artistes ont travaillé sur la lumière. Ann Veronica Janssens, m’a mis en confiance et m’a encouragé dans cette voie. J’aimais beaucoup Olafur Eliasson que j’aime moins aujourd’hui car il s’est peut-être perdu dans l’architecture et implique énormément de monde avec lui. Cependant il y avait cette petite installation avec une bougie reflétée par un miroir, c’est simple, poétique et ça ouvre un espace de réflexion, ça dilate le temps.
Reflection, 2010. Ampoule 15w, tissu réfléchissant, châssis, 80 x 80cm. © Florian Kleinefenn.
SR : Comment considères-tu les énoncés scientifiques d’optique? Par exemple les théories de la synthèse additive ou soustractive, etc. ?
JJ : Il y a aussi les théories d’Eugène Chevreul de la fin du XIXe siècle.
PPL : Un critique a également évoqué les travaux de Chevreul à propos de mon travail, mais je connais peu. En revanche j’ai lu l’ouvrage de Goethe Le traité des couleurs, qui est superbe car il est un peu outsider. Ce n’est pas comme Newton, dont les expériences servaient les avancées des sciences naturelles. Ses prises de notes suivent des codes scientifiques. La démarche de Goethe est plus littéraire et poétique. Il parle justement des aberrations chromatiques, toutes ces petites choses que la science met de côté.
JJ : Ce sont des phénomènes qui sont à la marge en fait.
PPL : Ce sont des phénomènes qui ne servent pas à la science disons « industrielle », c’est pour cela que Newton les écarte. Goethe venant de son domaine a une approche très différente. Il entreprend au contraire des recherches désintéressées sur la lumière et c’est très problématique. Il s’intéresse à la poésie des choses, à l’état des choses même si elle ne servent à rien. Il fait des recherches à la fois sur les manifestations de la couleur peinte et de la couleur dans la lumière. C’est un ouvrage exceptionnel, remarquablement bien écrit.
SR : Oui, tu as besoin que les choses t’apparaissent spontanément avant tout. Tu exclus volontairement la démarche qui consisterait à « vérifier » des hypothèses supposées par des théories dont tu prendrais connaissance en amont. Et avec le déplacement que tes pièces induisent, la perspective unique est remise en cause, cela permet d’ouvrir le champ, de sortir d’un certain perspectivisme.
PPL : Je ne lis pas d’ouvrages trop théoriques justement car ça tue l’érotisme comme tu disais. En revanche j’aime assez lire de petites rubriques dans des magazines scientifiques dans le style de Science et vie ou sur Internet. J’avais notamment lu un article sur les « réflexions totales internes ». En effet, j’avais réalisé une pièce, Cube (2010) qui consiste en un cube de Plexiglas présentant un angle tronqué. A première vue, il n’y a pas grand chose à voir en terme de phénomène. Je voulais reproduire cet effet : quand la lumière est enchâssée dans le matériau transparent et le rend miroitant. C’est exactement comme quand on est sous l’eau et que l’on regarde en hauteur . La surface devient totalement opaque, c’est le fond qui se réfléchit et on ne voit plus l’extérieur. Et c’est initialement cela qui m’intéressait, le mouvement du matériau qui est en principe transparent, mais qui se renverse, devient opaque et renvoie l’image. J’ai trouvé ça génial car c’est très simple à réaliser. On utilise ce phénomène dans les technologies de pointe. Dans les satellites par exemple, on recouvre leurs surfaces de tétraèdres. Le principe étant que la lumière pénètre à l’intérieur et revient à la source d’émission ; c’est ainsi que l’information circule. Ce sont des phénomènes de réflexion de la lumière. Internet c’est de la lumière, dans les câbles. C’est la lumière qui réfléchit et qui amène d’un point A à un point B. L’information passe dans des câbles mais aussi dans l’air. J’aime bien cette ouverture des possibles ; que cela prenne cette dimension-là. Et en même temps, que cela devienne un questionnement intéressant dans l’histoire de l’art, dans l’art contemporain. Quand on connaît le White cube, le socle, ces formes qui reviendront éternellement et que ce soit tronqué avec l’objet, qu’il y ait un geste plastique intéressant qui ne vient pas de la main, qui est industrialisé. Et quand un geste prend différents sens, ça commence à devenir intéressant… Donc en l’occurrence, si l’on prend l’objet comme il est, on n’a qu’une partie des choses et donc là il faut le commentaire autour pour se rendre compte.
Cube, 2010, plexiglas, 5 x 5 x 5 cm et 5 x 3 x 3 cm. ©Florian Kleinefenn.
JJ : Je voulais revenir à une œuvre que nous avons évoquée tout à l’heure : Abstraction (2012). C’est plutôt inhabituel dans ton travail car comme nous le disions, tu utilises des matériaux simples et industriels et ici la feuille d’or renvoie à une symbolique bien particulière.
PPL : Oui tout à fait. Je voulais être prudent car la feuille d’or en elle-même ne m’intéressait pas, étrangement. Beaucoup d’artistes ont travaillé avec la feuille d’or donc en terme de symbolique je trouvais cela un peu dangereux. Mais c’est suite à ce hasard d’atelier que j’évoquais. C’était un fond que j’avais initialement produit pour une pièce avec une lentille Fresnel, un tout autre travail. L’expérience ne s’était finalement pas avérée intéressante et était restée en attente dans un coin de l’atelier. Avec le temps (1 an exactement) je me suis rendu compte qu’elle ouvrait sur un espace intéressant, en nous plongeant dans un état contemplatif, même si l’objet regardé n’est finalement qu’une simple feuille légèrement pliée en son milieu.
SR : Justement c’est assez poétique dans la démarche, d’être dans une attitude passive. Mais je ne le dis pas d’une manière péjorative. L’idée est d’accueillir humblement les accidents, les hasards, ce qu’il se passe.
PPL : Oui, l’idée n’est pas d’influer sur les choses car elles sont en elles-mêmes sont déjà belles, et en général quand vous les modelez ça ne les arrange pas, on contraire, ça les personnifie trop.
SR : On comprend ton effacement vis-à-vis du geste dans l’ensemble de ton travail.
PPL :Oui, exactement.
SR : Dans Interférence (2010), tu superposes deux plaques de verre. Il y a une forme de tension d’où résulte un spectre coloré, comme une hyperbole. Peux-tu nous en dire plus sur ce dialogue entre calme et tension dans ton travail ?
PPL : La tension n’est pas gratuite. Car aussi calme que le travail puisse paraître il est aussi tout en tension. C’est un travail qui fait écho aux feuilles d’Inox tendues dans l’angle de la galerie. C’était une feuille droite pliée en deux et calée sur le mur. Cette pièce était en tension afin de révéler une interférence, selon toujours le même principe de la tâche d’essence sur la flaque d’eau qui décompose les rayons de la lumière d’une manière aléatoire et c’est le même procédé. Pour Interférence (qui est au format 80 x 80 cm ce qui revient souvent dans mon travail) y a deux verres : une plaque de verre peinte en noir et entre les deux il n’y a rien, uniquement de l’infra-mince. Cette dernière a pour fonction de révéler les anneaux et les aberrations chromatiques. Entre le mur et les plaques, j’ai placé des cales au centre de la pièce car ce sont les points de pression qui révèlent les franges colorées ; il y a un nom pour ça, ce sont les anneaux de Newton. J’ai créé cet écran afin d’obtenir un motif coloré obtenu par les conditions lumineuses et non par l’intervention de quelconques pigments colorés, car mis à part le fond noir il n’y a pas de peinture.
SR : Tu joues encore sur l’écart visible/invisible.
PPL : Oui et l’intervention est toute petite, elle existe mais on la voit peu.
SR : Il est beaucoup question de supports d’apparition, d’écran comme diffuseur autant que comme surface impénétrable, de transparence et d’opacité, comme par exemple dans Transparence (2010), pour laquelle tu superposes deux filtres polarisants. Tu as également travaillé sur la lecture vidéo (Instant, 2012) avec des images illisibles ou qui posent problème. Je me demandais dans quelle mesure tu revendiquais ton travail comme étant iconoclaste.
PPL : Oui, je vois. J’avais un travail qui se présentait comme iconoclaste, très minimal, avec des formes abstraites, et je suis venu avec ce travail sur l’image, les bugs informatiques où apparaissent des figures humaines et du texte. J’ai procédé à une capture d’écran d’un film au moment où l’image se détériore. J’ai essayé de le faire de manière décomplexée. J’étais intrigué dès que je voyais cette distorsion et cela me permettait des possibilités incroyables et des interprétations multiples de l’image. Elle n’est pas figée car ce dysfonctionnement peut tout aussi bien se produire à deux reprises comme n’avoir lieu qu’une seule fois au même endroit. C’est un léger un bug avec la timeline ; c’est étrange, moi-même ça me dépasse. Mais le résultat m’intéresse et j’ai développé une série d’images sur le même principe. Pour Jeune création je vais présenter une petite édition sur cette capture d’image et le bug que cela implique. On quitte le phénomène lumineux pour aboutir à la manière dont une image bascule dans autre chose, pour qu’ensuite la lecture se fasse hésitante.
Transparence, 2010. Film polarisant, Diasec, trépied, 130 x 60 x 60 cm chacun. © Florian Kleinefenn.
JJ : Et c’est un brouillage qui sollicite aussi l’interprétation du spectateur, c’est à nouveau des interstices à combler.
PPL : Oui, c’est exact. Sans savoir où aller, cela nous amène à une autre dimension.. Mais être surtout davantage dans l’image. Le cinéma m’intéresse et je n’en parle pas de manière explicite dans mon travail.
JJ : Même s’il y a la présence des projecteurs et des films, et donc une référence implicite.
PPL : C’est vrai. Mais à ce stade là c’est assez léger.
Instant, 2012. Capture d’écran 2011-02-04 à 22.51.21.png
JJ : Et on a l’impression qu’ils ne sont pas l’objet principal, tu les emploies davantage comme un support pour révéler le phénomène qui est à l’oeuvre.
PPL : Oui car dans le cinéma on trouve un grand nombre d’outils incroyables pour mettre un filtre en place sur un trépied, il y a un matériel infini et je préfère celui-ci au matériel scientifique, qui s’apparente plus à des instruments de torture. Il y a peut-être plus de poésie dans les outils du cinéma, davantage de choses à faire avec.
SR : Et la psychologie ? Par nécessairement dans ses aspects techniques mais plus en terme d’expérience. Nous avons parlé du rapport au temps et au fait d’être dans un certain état psychologique quand le temps s’étire. Cela laisse peut-être la place à de nouvelles apparitions lorsqu’on entre dans un autre état d’esprit, dans un certain état intérieur proche d’un état modifié de conscience.
PPL : Cela m’intéresse beaucoup, mais j’ai encore du mal à l’insérer dans mon travail car cela nécessite un bagage important. Je m’intéresse aux états méditatifs, à ce type d’expérience mais je ne demande pas aux spectateurs d’être transis devant mon travail. Parfois cependant il y a un état psychologique, des choses qui vont permettre d’aller vers un état méditatif ou qui vont être reposantes. Mais je ne fais pas de la luminothérapie. Il y a des pièces comme Particules, qui provoquent le vertige chez certaines personnes et un état de trouble et de déstabilisation. Comme cet effet de projection avec le RVB qui compose le blanc que l’on peut voir en clignant des yeux, en les tournant de gauche à droite. Cela questionne sur ce que l’on regarde, sur ce que l’on voit, qu’est-ce qu’il y a à voir devant soi, est-ce que c’est seulement dans le regard que ça se passe ?
SR : Je crois que l’on peut lier ça à tes problématiques vis-à-vis de l’image et ce que nous disions précédemment, sur les questions de surface, de support et de projection, quand on est davantage en présence de l’effet que de la représentation.
Oui. En fait c’est vrai, je n’aime pas faire des images, c’est compliqué.
Corner, 2010. Acier inoxydable brossé, 80 x 150 cm. © Florian Kleinefenn.
JJ : Reparlons de ton rapport à l’objet. Tu parles de sculpture mais ton travail se rapproche de l’installation. Quels statuts ont les objets qui composent tes sculptures ?
PPL : Ai-je vraiment un rapport particulier à la sculpture… J’ai certes été à l’atelier de sculpture de La Cambre mais j’ai finalement été amené à faire davantage de dispositifs que d’installations car ces dernières supposent des formats plus importants. Mais oui, des dispositifs. J’engage des objets qui ont strictement à voir avec le phénomène que je veux mettre en place et je prends en compte l’aspect sculptural de l’objet, évidemment. D’ailleurs j’aurais pu prendre le parti de ne pas être attentif à la forme, de mettre des scotches à la Thomas Hirschhorn, mais j’ai été amené à faire des choses plus propres, plus nettoyées. Je travaille autour de l’objet, oui et non, car il sert à quelque chose. Or la sculpture ne sert à rien. Ce qui est sculptural chez moi c’est vraiment l’expérience, qui est suscitée par un certain paramétrage du lieu de la lumière et de certaines matières. Mais il y a des considérations sculpturales, un objet même usuel, s’il a une fonction ou pas, peut-être très intéressant.
SR : C’est éclairant. Et qu’en est-il du choix de tes modes d’accrochage parfois proches de ceux de la peinture ou de la photographie ?
PPL : Oui, je me suis moi-même posé la question de mon rapport à la peinture car j’ai le sentiment d’en faire sans utiliser de pinceaux. C’est une bonne question mais je ne sais pas encore comment y répondre. Globalement cela revient à être à cheval entre le dispositif de la toile, l’image sur le mur et la sculpture. Celle-ci suscitant ainsi une lumière, un volume et un déplacement particuliers. Cependant un tableau aussi suscite un déplacement...
Quand je mets en place les choses je ne me demande pas si je suis dans le domaine de la sculpture, de la peinture ou de la photographie. C’est une bonne question à se poser a posteriori mais non quand je suis en train de le faire. La question suggérait-elle de savoir où on se situe ?
Comment situer par exemple Gerhard Richter, qui fait un travail incroyable sur l’image, la peinture et les objets, avec des miroirs, des verres transparents, etc… magnifiques. Comment le situer, il se considère davantage comme un peintre peut-être ?…